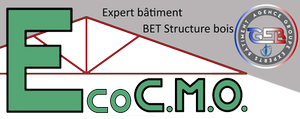Lorsqu’un bâtiment présente des lézardes, c’est-à-dire de larges fissures sur les murs et/ou le plancher après un été caniculaire, il peut être tentant d’en attribuer la cause à un épisode de sécheresse. Mais pour qu’un sinistre soit reconnu au titre de la CATNAT (Catastrophe Naturelle) sécheresse, il ne suffit pas d’observer ces fissures après une parution au Journal Officiel : il faut démontrer de façon rigoureuse que ces désordres sont bien la conséquence d’un phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA), lui-même causé par la sécheresse. On dit dans ce cas-là que l’on recherche l’élément déterminant du désordre.


Cette démonstration passe obligatoirement par des investigations géotechniques normalisées, encadrées par la norme NF P94-500. Cette norme définit le contenu, la méthodologie et le périmètre de chaque type de mission géotechnique. Elle garantit ainsi la qualité, la reproductibilité et la pertinence des résultats.
Seules les missions de type G5 encadrées par cette norme permettent d’établir de manière fiable l’origine du désordre. Les missions dites « G0 » avec investigations complémentaires ne sont pas encadrées par la norme et peuvent passer à côté des preuves recherchées. De plus, la mission G5 inclut une analyse objective par un ingénieur géotechnicien qui est le seul intervenant légitime pour formuler une prescription de réparation, prévalant même sur l’avis des experts.
La mission G5 permet exhaustivement :
- de déterminer la profondeur et la nature des fondations,
- d’identifier le type de sol en place par sondages et prélèvements, car Géorisques ne permettra que de donner une indication approximative sur les sols,
- de réaliser une analyse sédimentométrique fine jusqu’à 2 microns pour détecter la présence d’argiles sensibles au retrait et d’établir un classement GTR,
- d’établir l’indice de plasticité des argiles,
- d’identifier une éventuelle présence d’eau (investigation hydrologique),
- de faire une prescription de réparation.
Pour garantir la fiabilité des résultats, il est fortement recommandé de réaliser les prélèvements en double, et de les faire analyser par deux laboratoires distincts lorsque la question de la responsabilité est en jeu.
Au-delà de l’étude géotechnique, la reconnaissance d’un lien entre le désordre et une sécheresse nécessite également une analyse contextuelle :
- Vérifier que le désordre n’est pas apparu après de fortes pluies, auquel cas la sécheresse n’est peut-être pas en cause.
- Examiner la présence d’arbres ou de haies à proximité, pouvant provoquer des collisions racinaires.
- Envisager le phénomène de turbo-succion des sols, causé par des radicelles qui aggravent le retrait gonflement du sol en période sèche.
- Et enfin, s’assurer de la publication d’un arrêté interministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle au Journal Officiel, pour la commune et la période concernées.
En résumé, une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle pour sécheresse repose sur une démarche structurée, pluridisciplinaire et encadrée par la norme NF P94-500. Toute analyse superficielle ou hors cadre normatif risque d’être rejetée, au détriment de l’assuré. Il est donc essentiel de s’appuyer sur des missions géotechniques reconnues, comme la G5, et de faire analyser par le cabinet d’expertise du Groupe Expert Bâtiment (GEB) de votre département (pour le 64 : GEB 64 ou directement EcoCMO), l’ensemble des éléments de contexte pour établir un diagnostic solide et recevable.